
Peut-on être un romancier populaire et entrer dans l’élite des littérateurs ? La réponse est indubitablement oui. Auteur populaire et académicien, comme Jacques Laurent, surtout connu sous le pseudonyme de Cécil Saint-Laurent avec son héroïne phare Caroline chérie, ou encore Henri Troyat pour ses sagas dont Les Semailles et les moissons ou encore Les Eygletière, Pierre Benoit est considéré par Gérard de Cortanze comme un romancier paradoxal. Mais pourquoi le définir ainsi ?
C’est ce que le lecteur va découvrir en lisant cet ouvrage jubilatoire et vivant consacré à l’auteur de Kœnigsmarck, de L’Atlantide, d’Axelle, de Mademoiselle de La Ferté et bien d’autres encore, des romans dont le succès littéraire ne se dément pas.
Né à Albi le 16 juillet 1886, d’une mère aquarelliste, musicienne, cultivée, aux idées politiques monarchistes, et d’un père issu d’une lignée de gens de droit mais qui préféra embrasser la carrière militaire en entrant dans la prestigieuse école de Saint-Cyr puis s’engageant comme volontaire dans l’armée de la Loire créée après la défaite de Sedan en 1870 et combattit en Kabylie, Pierre Benoit va souvent en vacances à Saint Paul les Dax, chez sa grand-mère. Ne sachant pas encore lire, à deux ans il est capable de réciter par cœur dix-sept fables de La Fontaine. Plus tard il sera capable de réciter des milliers de vers, empruntés aux tragédies de Racine mais surtout des poèmes de Victor Hugo.
En 1891, il suit ses parents en Tunisie, son père y étant affecté. Ce sera d’abord Tunis, puis Sfax, Sousse, Gabès, puis l’Algérie. Des images, des rencontres qu’il garde en mémoire et qu’il ressortira plus tard pour les intégrer à ses romans.
Il n’est pas de mon intention de me substituer à Gérard de Cortanze et vous  résumer en entier la vie de Pierre Benoit. Donc je me conterai de relever quelques faits significatifs, quelques épisodes de la carrière de l’auteur dont nous célébrons cette année le cinquantenaire de la disparition.
résumer en entier la vie de Pierre Benoit. Donc je me conterai de relever quelques faits significatifs, quelques épisodes de la carrière de l’auteur dont nous célébrons cette année le cinquantenaire de la disparition.
Passons rapidement sur ses années d’enfance, ses joies, ses études et arrêtons-nous sur son arrivée à Paris. Il est maitre d’internat à Montpellier et assiste aux conférences de Maurice Barrès et Charles Maurras, qui deviendront ses maîtres à penser. Il est licencié es-lettres mais a échoué à son agrégation en 1910. Il réussit toutefois à un concours du ministère du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts. Il est employé comme agent dans le sous-secrétariat aux Beaux-arts, puis bibliothécaire au ministère de l’Instruction publique, publiant à la même époque ses premiers poèmes. Mais ce n’est pas encore la gloire. Son recueil Diadumène en 1914 ne se vendra qu’à cinq exemplaires et encore au même acheteur, un mécène. Il s’essaie à un autre exercice, qui est plus difficile qu’il y parait : celui du pastiche, car c’est un farceur dans l’âme. Sous l’impulsion d’un certain Guyot qui est le maître d’œuvre d’un ouvrage intitulé Comme dirait… publié chez Oudin et Cie, il écrit anonymement trois pastiches d’Anna de Noailles dont il deviendra l’ami, de Victor Hugo et d’Honorat du Bueil de Racan. Il se lie avec Francis Carco, Roland Dorgelès, Pierre Mac Orlan. Il est mobilisé au début de la Première Guerre Mondiale mais il tombe gravement malade à la bataille de Charleroi. Alors qu’au début des hostilités il pensait participer à une Guerre sainte, son opinion se transforme radicalement et il devient un pacifiste convaincu.
Si son premier roman, Kœnigsmark est publié en 1918, chez Emile-Paul frères, les autres le seront tous chez Albin Michel. Dès sa parution en volume qui fait suite à une publication en feuilleton au Mercure de France, ce roman trouve l’adhésion du public et manque de peu le Prix Goncourt. Pourtant Pierre Benoit avait auparavant essuyé de nombreux refus. C’est lisant cette revue que l’éditeur Albin Michel découvre cet auteur inconnu mais selon lui prometteur. Editeur scrupuleux, Albin Michel ne tente pas de débaucher Pierre Benoit, de lui offrir plus que son confrère, mais décide d’attendre le prochain roman de cet auteur promis à un bel avenir. Autre attention à souligner, et je sais que certains auteurs aimeraient que ce genre de proposition leur soit faite, Albin Michel offre une mensualité de quatre cents francs, alors même qu’il n’interroge pas le futur académicien sur le contenu de son prochain roman. Il a cette phrase qui fait chaud au cœur lorsqu’un romancier débute : un écrivain doit pouvoir vivre de sa plume. Et je connais certains auteurs qui aimeraient qu’un éditeur émette une offre semblable préférant devenir des ouvriers mensualisés de l’écriture au lieu d’être des artisans attendant le chaland.
Le suivant, L’Atlantide, sera un succès de librairie encore plus important, couronné par le Grand Prix de l’Académie Française en 1919. Ce sera le début d’une impressionnante série de réussites littéraires.
Les années s’écoulant entre 1920 et 1944 seront riches en événements, 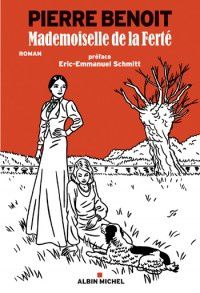 avec en point de crêt son élection à l’académie française en 1931, alors qu’il a quarante-cinq ans. En 1937, il rédige des articles pour le quotidien Le Journal. Il se rend en Autriche et en Palestine afin de se renseigner sur les mouvements anti-juifs. Il est l’un des premiers à mettre en garde ses concitoyens sur l’éventualité d’une action allemande en Autriche : Il y a à Vienne, pour les promeneurs qui s’en vont flânant par les rues, une bien étrange distraction. Elle consiste à faire le compte des passants portant des bas blancs. C’est là, en effet, le signe de ralliement des nazis autrichiens. Ces messieurs, on peut s’en douter, sont les adversaires les plus farouches de la restauration monarchique. Suivent des interrogations concernant l’avenir et la puissance réelle du parti national-socialiste. En avril 1938, il est reçu par Goering, lequel se met à quatre pattes pour tenter d’ouvrir un coffre-fort qui contient les plans d’un nouvel avion qu’il veut montrer à son interlocuteur, lequel, médusé et inconscient, pense qu’il pourrait lancer un beau coup de pied dans l’imposant postérieur du dignitaire nazi, ce qui ne changerait pas la face du monde mais ferait sans doute son effet ! Rentré à Paris Pierre Benoit, au lieu de publier un article décide d’informer verbalement le ministre des Affaires étrangères de ce qu’il a observé, et lui envoie donc un courrier dans lequel il lui demande un rendez-vous. Il ne reçoit aucune réponse. Dépité notre écrivain-journaliste décide de ne plus s’occuper des événements politiques internationaux et ne se consacrer uniquement qu’à ses travaux littéraires.
avec en point de crêt son élection à l’académie française en 1931, alors qu’il a quarante-cinq ans. En 1937, il rédige des articles pour le quotidien Le Journal. Il se rend en Autriche et en Palestine afin de se renseigner sur les mouvements anti-juifs. Il est l’un des premiers à mettre en garde ses concitoyens sur l’éventualité d’une action allemande en Autriche : Il y a à Vienne, pour les promeneurs qui s’en vont flânant par les rues, une bien étrange distraction. Elle consiste à faire le compte des passants portant des bas blancs. C’est là, en effet, le signe de ralliement des nazis autrichiens. Ces messieurs, on peut s’en douter, sont les adversaires les plus farouches de la restauration monarchique. Suivent des interrogations concernant l’avenir et la puissance réelle du parti national-socialiste. En avril 1938, il est reçu par Goering, lequel se met à quatre pattes pour tenter d’ouvrir un coffre-fort qui contient les plans d’un nouvel avion qu’il veut montrer à son interlocuteur, lequel, médusé et inconscient, pense qu’il pourrait lancer un beau coup de pied dans l’imposant postérieur du dignitaire nazi, ce qui ne changerait pas la face du monde mais ferait sans doute son effet ! Rentré à Paris Pierre Benoit, au lieu de publier un article décide d’informer verbalement le ministre des Affaires étrangères de ce qu’il a observé, et lui envoie donc un courrier dans lequel il lui demande un rendez-vous. Il ne reçoit aucune réponse. Dépité notre écrivain-journaliste décide de ne plus s’occuper des événements politiques internationaux et ne se consacrer uniquement qu’à ses travaux littéraires.
Pierre Benoit a gardé son esprit farceur, et prenant au mot une boutade d’Henri Miller qui a déclaré : Il faudrait absolument faire rigoler Hitler, sinon nous sommes tous foutus, il envoie un télégramme cosigné Carco et Dorgelès, un télégramme ainsi rédigé : Trois écrivains français vous souhaitent un bon anniversaire à condition que ce soit le dernier. Tout le monde n’apprécie pas cette farce qui se retournera contre son auteur à la Libération. En effet, paradoxalement, en 1944, il est comme bon nombre d’écrivains ayant publié sous l’Occupation, arrêté et transféré à Fresnes le temps de l’instruction. Mais en 1945 il est libéré pour manque de preuves mais interdit de publier durant deux ans. Des preuves les juges qui instruisaient et jugeaient les faits auraient été en peine d’en trouver, à moins de les fabriquer. Ce qui n’était pas le cas pour des auteurs tels que Brasillach, Drieu La Rochelle ou Céline. Or ces magistrats étaient des anciens des Sections Spéciales près des Cours d'Appel pour condamner à mort ou à la déportation, les résistants durant l'occupation.
Sautons allégrement les années et arrêtons-nous en 1959. Pierre Benoit va jeter un pavé dans la mare en donnant sa démission de l’Académie française en signe de protestation contre le veto du général de Gaulle à l’élection de Paul Morand. Comme l’Académie ne reconnaît pas la démission de ses membres, le démissionnaire est dans ce cas autorisé à ne plus assister aux séances. Ce qui est une forme d’hypocrisie.
 La carrière de Pierre Benoit ne s’est pourtant pas déroulée sans anicroches. Il s’est attiré l’ire de critiques célèbres et influents comme Paul Souday. Au-delà de la jalousie, ce que reproche Paul Souday à Pierre Benoit, ce sont ses sympathies droitières. Mais comme le souligne avec discernement Gérard De Cortanze, l’idéologie politique appliquée à la littérature est un des grands classiques de la critique : on attaque l’homme avant d’attaquer l’œuvre.
La carrière de Pierre Benoit ne s’est pourtant pas déroulée sans anicroches. Il s’est attiré l’ire de critiques célèbres et influents comme Paul Souday. Au-delà de la jalousie, ce que reproche Paul Souday à Pierre Benoit, ce sont ses sympathies droitières. Mais comme le souligne avec discernement Gérard De Cortanze, l’idéologie politique appliquée à la littérature est un des grands classiques de la critique : on attaque l’homme avant d’attaquer l’œuvre.
Ecrivain populaire Pierre Benoit l’était réellement. Par essence, par conviction. Paul Souday, toujours lui, décrétant dans les colonnes du Temps que Kœnigsmark fait partie de ces livres qu’on lit le temps d’un voyage en train, ce qu’on appelle « un roman de gare », Pierre Benoit rétorque dans L’Automobile et l’Ecrivain en novembre 1949 : J’ai déploré, dans l’avènement de l’automobile, le tort irrémédiable qu’elle fait à la lecture, surtout depuis que les femmes, nos principales clientes, à nous romanciers, se sont mises à conduire. Le livre s’est accommodé à merveille du chemin de fer, la preuve en est dans l’importance des bibliothèques de gares. On chercherait en vain des bibliothèques dans les garages.
Gérard de Cortanze a écrit une biographie que l’on pourrait presque considérer comme un roman, tant celle-ci est intéressante, prenante, ensorcelante, à laquelle le lecteur a du mal à se détacher, enthousiaste, claire, distrayante et qui donne envie de se replonger dans l’œuvre de Pierre Benoit et d’en découvrir toutes les subtilités, toutes les facettes, le tout étayé par une solide et impressionnante documentation et une très riche iconographie. Tout au plus pourra-t-on regretter un manque de repères chronologiques en fin d’ouvrage ainsi qu’une bibliographie exhaustive de Pierre Benoit.
Gérard de CORTANZE : Pierre BENOIT, le romancier paradoxal. Editions Albin Michel. 574 pages. 25 €.
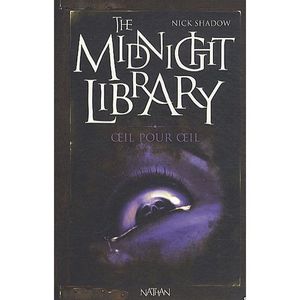






 résumer en entier la vie de Pierre Benoit. Donc je me conterai de relever quelques faits significatifs, quelques épisodes de la carrière de l’auteur dont nous célébrons cette année le cinquantenaire de la disparition.
résumer en entier la vie de Pierre Benoit. Donc je me conterai de relever quelques faits significatifs, quelques épisodes de la carrière de l’auteur dont nous célébrons cette année le cinquantenaire de la disparition.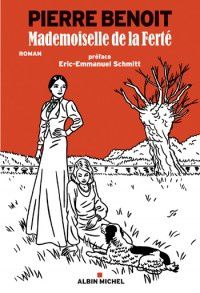 avec en point de crêt son élection à l’académie française en 1931, alors qu’il a quarante-cinq ans. En 1937, il rédige des articles pour le quotidien Le Journal. Il se rend en Autriche et en Palestine afin de se renseigner sur les mouvements anti-juifs. Il est l’un des premiers à mettre en garde ses concitoyens sur l’éventualité d’une action allemande en Autriche : Il y a à Vienne, pour les promeneurs qui s’en vont flânant par les rues, une bien étrange distraction. Elle consiste à faire le compte des passants portant des bas blancs. C’est là, en effet, le signe de ralliement des nazis autrichiens. Ces messieurs, on peut s’en douter, sont les adversaires les plus farouches de la restauration monarchique. Suivent des interrogations concernant l’avenir et la puissance réelle du parti national-socialiste. En avril 1938, il est reçu par Goering, lequel se met à quatre pattes pour tenter d’ouvrir un coffre-fort qui contient les plans d’un nouvel avion qu’il veut montrer à son interlocuteur, lequel, médusé et inconscient, pense qu’il pourrait lancer un beau coup de pied dans l’imposant postérieur du dignitaire nazi, ce qui ne changerait pas la face du monde mais ferait sans doute son effet ! Rentré à Paris Pierre Benoit, au lieu de publier un article décide d’informer verbalement le ministre des Affaires étrangères de ce qu’il a observé, et lui envoie donc un courrier dans lequel il lui demande un rendez-vous. Il ne reçoit aucune réponse. Dépité notre écrivain-journaliste décide de ne plus s’occuper des événements politiques internationaux et ne se consacrer uniquement qu’à ses travaux littéraires.
avec en point de crêt son élection à l’académie française en 1931, alors qu’il a quarante-cinq ans. En 1937, il rédige des articles pour le quotidien Le Journal. Il se rend en Autriche et en Palestine afin de se renseigner sur les mouvements anti-juifs. Il est l’un des premiers à mettre en garde ses concitoyens sur l’éventualité d’une action allemande en Autriche : Il y a à Vienne, pour les promeneurs qui s’en vont flânant par les rues, une bien étrange distraction. Elle consiste à faire le compte des passants portant des bas blancs. C’est là, en effet, le signe de ralliement des nazis autrichiens. Ces messieurs, on peut s’en douter, sont les adversaires les plus farouches de la restauration monarchique. Suivent des interrogations concernant l’avenir et la puissance réelle du parti national-socialiste. En avril 1938, il est reçu par Goering, lequel se met à quatre pattes pour tenter d’ouvrir un coffre-fort qui contient les plans d’un nouvel avion qu’il veut montrer à son interlocuteur, lequel, médusé et inconscient, pense qu’il pourrait lancer un beau coup de pied dans l’imposant postérieur du dignitaire nazi, ce qui ne changerait pas la face du monde mais ferait sans doute son effet ! Rentré à Paris Pierre Benoit, au lieu de publier un article décide d’informer verbalement le ministre des Affaires étrangères de ce qu’il a observé, et lui envoie donc un courrier dans lequel il lui demande un rendez-vous. Il ne reçoit aucune réponse. Dépité notre écrivain-journaliste décide de ne plus s’occuper des événements politiques internationaux et ne se consacrer uniquement qu’à ses travaux littéraires. La carrière de Pierre Benoit ne s’est pourtant pas déroulée sans anicroches. Il s’est attiré l’ire de critiques célèbres et influents comme Paul Souday. Au-delà de la jalousie, ce que reproche Paul Souday à Pierre Benoit, ce sont ses sympathies droitières. Mais comme le souligne avec discernement Gérard De Cortanze, l’idéologie politique appliquée à la littérature est un des grands classiques de la critique : on attaque l’homme avant d’attaquer l’œuvre.
La carrière de Pierre Benoit ne s’est pourtant pas déroulée sans anicroches. Il s’est attiré l’ire de critiques célèbres et influents comme Paul Souday. Au-delà de la jalousie, ce que reproche Paul Souday à Pierre Benoit, ce sont ses sympathies droitières. Mais comme le souligne avec discernement Gérard De Cortanze, l’idéologie politique appliquée à la littérature est un des grands classiques de la critique : on attaque l’homme avant d’attaquer l’œuvre.






/image%2F1226821%2F20150107%2Fob_17597e_paul-maugendre.jpg)
 Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter
Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter 