
Se retrouver face à un jeune homme, à la peau brune, maigre, vêtu d’un manteau trempé, incite à refermer la porte sur lui plutôt qu’à la laisser entrouverte, ou même l’inviter à entrer. Et Virginia Colar balance entre les deux solutions, l’éconduire ou accéder à sa demande de chambre. Car Virginia loue des chambres, mais l’homme qui se tient devant elle ne l’inspire pas vraiment. Enfin, surmontant sa répulsion, elle accepte de le loger, à condition qu’il ait les moyens de la régler. Il sort des billets froissés et des pièces de monnaie noircies comme s’il les avait gardées des années dans une boîte en ferraille parmi d’autres objets rouillés.
Il prétend se nommer Robert X. à l’instar de ceux qui appartiennent à cette organisation, dont elle ne sait plus trop bien le nom, les Black Panthers ou les Black Muslims. Mais du moment qu’il peut payer d’avance et qu’il ne se montre pas trop dérangeant, pourquoi pas ? Robert X. effectivement sait se montrer discret. Pas de bruit dans sa chambre, tout juste s’il lui répond quand elle lui apporte un bol de soupe pour qu’il se réchauffe. Juste pour savoir s’il y a une église baptiste dans le coin. Par Fletcher, le chauffeur de taxi de Sainte Adrienne, ville située non loin de Bâton rouge en Louisiane, qui voit tout ce qui se passe dans la petite ville, elle apprend que son locataire, qui a dit venir de Chicago, se promène le soir, qu’il déambule ou alors qu’il stationne de longues heures la nuit assis devant la porte de l’église du pasteur Phillip Martin. Un étrange étranger…
Elijah, instituteur à l’école primaire de Sainte Adrienne, habite chez les Martin. Alors qu’il est en voiture, il propose à Robert X. de le déposer en voiture, là où il le désire. Et parvient à le faire parler, un peu. Robert X. déclare vouloir assister à une conférence, la conférence d’un homme noir, sans plus. Sur une impulsion, peut-être parce que l’homme lui est sympathique ou solitaire, il l’invite à une soirée qui doit se dérouler deux jours plus tard, un samedi, lui promettant qu’un couple d’amis, Sheperd et sa copine Beverly tous deux enseignants, viendront le chercher.
Ainsi fut dit, ainsi fut fait.
Le samedi, dans la maison du révérend Phillip Martin, de nombreuses personnes sont présentes, et pas uniquement pour boire un verre. Le pasteur est aussi le président d’un comité de défense des droits civiques, et une action est envisagée afin d’obliger Chenal, le plus gros commerçant de la ville, de payer ses employés Noirs sur le même pied d’égalité que les Blancs. Robert X. refuse d’enlever son manteau, malgré la proposition d’Alma la femme de Phillip Martin, et se tient à l’écart des invités. Lorsque l’archidiacre Mills le remarque, il lui semble bien avoir déjà vu ce visage quelque part. Mais lorsque les yeux du pasteur se posent sur lui, c’est comme s’il voit un fantôme. Et il s’effondre. Ses amis affirment qu’il s’agit d’un malaise, provoqué par la fatigue. L’une des femmes présentes, sourde et donc n’entendant pas les explications, affirme qu’il est ivre. Ah, ces jugements énoncés sans fondement et colportés comme les pistils du pissenlit. Personne ne prend dessus heureusement. Mais Phillip Martin est vraiment mal en point. Il se cloître dans un mutisme qui inquiète Alma et ses amis, ses trois jeunes enfants aussi. Il est déboussolé, sort de sa chambre à l’insu de sa femme, et est en proie à l’incertitude, se posant de multiples questions. Non, pas de doute, ce Robert X. est son fils, l’un des enfants qu’il a eu lors d’une de ses nombreuses relations charnelles avant son mariage quinze ans auparavant avec Alma.
Il le revoit beaucoup plus jeune, mais ne se souvient plus de son prénom. Il lui faut le retrouver, s’expliquer avec lui, renouer qui sait. L’homme fort, digne, droit dans ses bottes, confiant en lui, imbu de ses prérogatives, de son influence, de sa force, de son charisme, n’est plus qu’un homme en proie aux doutes, aux interrogations.
Ernest J. Gaines, le chantre de l’Amérique noire sudiste, ne se contente pas de narrer les retrouvailles difficiles entre un homme et son fils. C’est l’Amérique de la fin des années soixante qu’il décrit, une Amérique rongée encore par le racisme et la ségrégation, mais également les rapports conflictuels en deux générations. La condition des Noirs américains n’a que peu évoluée, et ils sont toujours victimes d’un système de rejet. Vous croyez que la loi, elle devrait s’occuper de la famille à la place du père ? D’après la loi, elle a même pas été violée. Les filles noires, ça se fait pas violer ; elles provoquent leurs violeurs, les filles noires.
Cette Amérique qui est contente de trouver de jeunes Noirs pour combattre et assurer la défense du monde, elle les oublie lorsqu’ils rentrent au foyer. Quand ils rentrent, ils leur donnent rien à faire, ni travail, ni rien du tout. Et quand ils volent de la nourriture pour pouvoir manger, ils les tuent. Dans quel monde est-ce que nous vivons !
Le ressentiment des Noirs envers les Blancs est de plus en plus prégnant et certains envisagent même de tout brûler. Ce pays est la dernière béquille de la civilisation occidentale, du moins de ce qu’eux, ils appellent « civilisation ». En le brûlant, on la détruit, la civilisation occidentale. On remet le monde comme il était et on repart à zéro. Un ressentiment qui envisage un extrémisme parmi les plus exaltés. Mais sur le fond ont-ils vraiment tort ? Et cet esprit de fronde est partagé par de nombreux Noirs, même pacifistes. Y’a que deux choses que le Blanc comprend, m’sieur : les balles et le feu. Ce pays tout entier a été construit par les balles et le feu. Allez demander aux Indiens, aux Japonais ; allez demander aux Coréens, aux Vietnamiens. Rien que des gens de couleur. Même quand il lynche un nègre, il faut qu’il le brûle.
Ernest J. Gaines prenant pour base une histoire simple, un fils prodigue renié par son père et rentrant au foyer pour y accomplir ce qu’il lui semble être un devoir, vis-à-vis de sa mère et de ses deux frère et sœur, trempe peu à peu sa plume dans un encrier où a été ajouté un peu de vitriol, dénonçant les injustices, les inégalités, sachant que ses écrits ne resteront que des écrits, des idées couchées sur le papier pour mieux alerter ses compatriotes des rancœurs qui commencent à bouillonner dans le cœur et l’esprit de ses frères de couleur.
D'Ernest J. Gaines, lire également : Par la petite porte et Colère en Louisiane
Ernest J. GAINES : Le nom du fils (In my father’s house – 1978. Traduit par Michelle Herpe-Voslinsky et Jean-François Gauvry). Editions Liana Levi. 15 mai 2013. 272 pages. 19,00€.

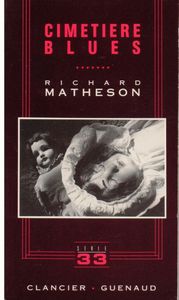




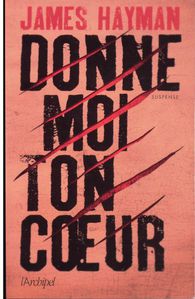

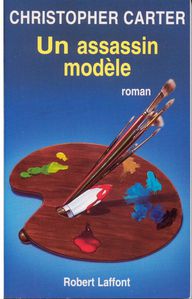
 Ce qui n’empêche pas l’auteur de brocarder gentiment les artistes, ou plutôt une conception de l’art et du spectacle qui, sous couvert de créativité, se permet n’importe quoi et principalement de jouer dans la vulgarité, synonyme pour certains de modernité. L’aspect roman noir et sociologique est édulcoré car seul l’esprit ludique plane sur cette collection, n’en déplaise aux esprits chagrins qui voudraient que tout roman soit axé sur le message politique, social ou autre. Il est bon parfois de se reposer les neurones, d’échapper aux vicissitudes de la vie quotidienne, de se laisser à lire sans réfléchir.
Ce qui n’empêche pas l’auteur de brocarder gentiment les artistes, ou plutôt une conception de l’art et du spectacle qui, sous couvert de créativité, se permet n’importe quoi et principalement de jouer dans la vulgarité, synonyme pour certains de modernité. L’aspect roman noir et sociologique est édulcoré car seul l’esprit ludique plane sur cette collection, n’en déplaise aux esprits chagrins qui voudraient que tout roman soit axé sur le message politique, social ou autre. Il est bon parfois de se reposer les neurones, d’échapper aux vicissitudes de la vie quotidienne, de se laisser à lire sans réfléchir.




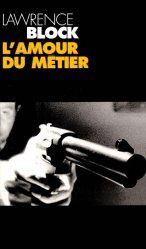
/image%2F1226821%2F20150107%2Fob_17597e_paul-maugendre.jpg)
 Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter
Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter 