Hommage à Jean Forton né le 16 juin 1930.

Ecrire un roman à la première personne, c’est mettre un peu de soi dans l’intimité du personnage-narrateur et il est parfois difficile de dissocier la fiction de la réalité. Renfermé, solitaire, notre héros (au sens de personnage principal) tient une sorte de journal de bord non daté, une façon personnelle de coucher sur le papier ses avatars afin de mieux les revivre.
Il n’a pas grand-chose à faire dans une existence oisive, percevant une rente mensuelle d’un héritage paternel. Son frère perpétue le négoce en vin qu’avait créé leur père et lui, il encaisse tous les mois sa quote-part. Il ne se plaint pas, même s’il pense être grugé, d’ailleurs que pourrait-il réclamer, lui qui à part se présenter pour toucher son obole ne participe en rien à l’entreprise familiale.
Il baguenaude, il vadrouille, il observe, habillé le plus souvent de fripes informes, se moquant totalement de son apparence, du regard des passants honnêtes comme le chantait Brassens. Il fréquente peu, et ne prend plaisir qu’en établissant des liaisons avec êtres blessés par la vie qui n’attendent plus rien de l’avenir. Ce sont les rares qui trouvent grâce à ses yeux « c’était un être frustre, et par bien des côtés plus proche de la bête que de l’homme. Mais il avait atteint un tel degré de misère qu’il avait bien le droit d’avoir une opinion ».
Il s’encanaille car ses fréquentations ne le jugent pas, négativement ou non : « En moi sommeillent de bas instincts, je ne participe vraiment aux joies collectives qu’avec des gens simples, des ivrognes. Ils ne me jugent pas, ils n’en ont pas le temps. Et s’ils le font malgré tout, ils ont la délicatesse de n’en laisser rien voir ». Un peu plus loin il écrit : « Ces rencontres d’un soir, ces amitiés d’une heure, m’ont toujours semblé précieuses. Il y a, dans cette intimité que rien ne vient troubler, une liberté, une franchise qu’interdisent les longs rapports ».
Une profession de foi qui se racornit un beau jour, lorsqu’il croise par hasard une jeune fille à la sortie d’un pensionnat. Il la trouve belle, en tombe amoureux et grâce à sa persévérance, sa volonté, sa patience, sa gentillesse, il va peu à peu apprivoiser ce petit oiseau et l’emmener dans sa cage. La belle, dont le père est lui aussi riche négociant en vin, est naïve. Faut dire qu’entre un père absorbé par son travail et une mère atteinte d’une sorte de maladie récurrente, Isabelle ne connait rien à la vie. Il va se charger de son apprentissage, lui apprendre à manquer l’école, à sortir de sa réserve, à s’émanciper. Il l’aime mais parfois regrette que sa présence soit trop effective, car il reste profondément solitaire dans l’âme. « Dieu sait que je l’aime, mais il arrive parfois que sa présence me pèse…On devrait interdire, même aux maîtresses les plus chères, certains lieux secrets où elles n’ont pas leur place ». Il n’est pas franchement cynique et pourtant il agit comme tel. Et sa grande question sera « A quoi me sert d’aimer si je dois souffrir ? ».
Par essence un lecteur est un être curieux, et ne dérogeant pas à cette assertion, j’ai entamé ce roman par la fin afin de recueillir quelques renseignements, le nombre de pages, la date d’imprimerie, la lecture de la postface sensible et érudite de Catherine Rabier Darnaudet, et plein de petites autres bricoles. Ainsi en apprenant que ce roman n’était tiré qu’a deux mille deux cent vingt deux exemplaires, je ne peux m’empêcher de penser qu’il n’y en aura pas pour tout le monde et que seuls les premiers seront servis, alors n’hésitez pas à vous le procurer.
 Considéré comme son chef d’œuvre (je ne peux juger n’ayant pas lu les autres ouvrages de cet auteur, une lacune que je ne devrais pas tarder à combler), La Cendre aux yeux de Jean Forton pourrait passer pour un roman nombriliste. Cela se dément bien vite car le lecteur, qui suit les pensées du narrateur, peut se demander à juste raison si cette histoire n’est pas la sienne, ou tout au moins une aventure qu’il aurait pu vivre. Evidemment il faut s’investir, endosser le rôle et se plonger dans les années cinquante, quand les relations Filles/Garçons relevaient d’un code qui n’existe plus, d’une façon de penser et de se conduire qui sont devenues obsolètes. Il plane sur cet ouvrage comme un parfum d’authenticité qui relève plus de la confession que de l’imaginaire, avec un petit goût d’autodérision salutaire.
Considéré comme son chef d’œuvre (je ne peux juger n’ayant pas lu les autres ouvrages de cet auteur, une lacune que je ne devrais pas tarder à combler), La Cendre aux yeux de Jean Forton pourrait passer pour un roman nombriliste. Cela se dément bien vite car le lecteur, qui suit les pensées du narrateur, peut se demander à juste raison si cette histoire n’est pas la sienne, ou tout au moins une aventure qu’il aurait pu vivre. Evidemment il faut s’investir, endosser le rôle et se plonger dans les années cinquante, quand les relations Filles/Garçons relevaient d’un code qui n’existe plus, d’une façon de penser et de se conduire qui sont devenues obsolètes. Il plane sur cet ouvrage comme un parfum d’authenticité qui relève plus de la confession que de l’imaginaire, avec un petit goût d’autodérision salutaire.
Jean FORTON : La cendre aux Yeux. Editions Le Dilettante. Postface de Catherine Rabier-Darnaudet. Octobre 2009. 320 pages. 19,00€.




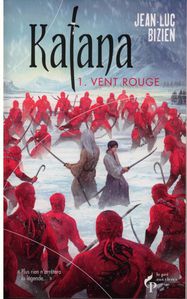
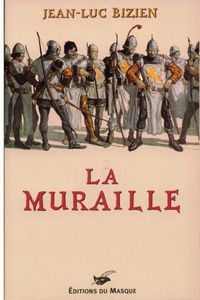




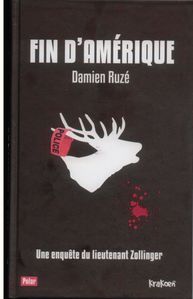

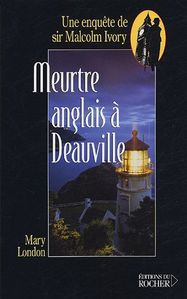

/image%2F1226821%2F20150107%2Fob_17597e_paul-maugendre.jpg)
 Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter
Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter 