
Pourriez-vous vous présenter : date de naissance, lieu, profession, parcours…
Je suis né le jour du printemps de 1946 au Rove. J’ai gardé les chèvres jusqu’à l’âge de 11 ans avant de rejoindre l’internat d’un lycée marseillais. Ensuite, les études m’ont mené jusqu’à un doctorat de mathématique. Sur le plan professionnel, j’ai choisi très tôt l’informatique - c’était l’époque des gigantesques calculateurs qui avalaient des tonnes de cartes perforées – et j’ai suivi depuis le début cette extraordinaire aventure qui a bouleversé notre société. J’ai eu l’occasion également de mener quelques missions pour le compte de la FAO et de beaucoup voyager.
Bon nombre de romanciers, quelque soit leur domaine, avouent être entrés en littérature en se faisant la main d’abord en écrivant des poèmes. Est-ce votre cas ?
Certainement. Mes origines pastorales étaient empreintes de poésie. Dans ma famille, on était berger, conteur ET poète, mais on ne se prenait pas la tête avec les alexandrins et les envolées lyrique. La poésie était simple et cela m’a donné le goût des mots et des histoires.
Si je pose cette question c’est parce que vous faites souvent référence à des poètes locaux comme Louis Brauquier. L’avez-vous personnellement connu, puisque ce poète dont le thème de prédilection était le monde maritime ?
Je n’ai pas connu Brauquier, mais il donne une image du port de Marseille un peu nostalgique et populaire. J’aime bien, également, Victor Gélu mais ses poèmes en provençal seraient plus difficiles à « placer ».
Ce n’était qu’un interlude. Comment vous est venue cette envie d’écrire, et surtout d’écrire des romans noirs de la mémoire, et avez-vous eu du mal à trouver un éditeur ?
L’envie d’écrire a toujours existé en moi, mais ma formation scientifique ne me 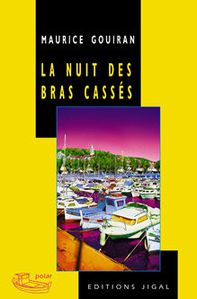 prédisposait pas à cet exercice. Avec la maturité, cette envie est devenue nécessité, mais j’ai compris qu’il s’agissait avant tout d’écrire des histoires. Je crois que les lecteurs demandent avant tout qu’on leur raconte des histoires. Le style que j’utilisais dans mes ouvrages de vulgarisation était bien adapté au type de romans que je voulais écrire. Mon attrait pour les quartiers de Marseille et pour les non-dits de l’Histoire a fait le reste. Mon ambition initiale n’était pas du tout d’être édité. C’est lorsque j’ai fait lire mon premier manuscrit à mon entourage que cette idée bizarre m’est venue. J’ai arrosé quelques maisons d’édition avec « La nuit des bras cassés », puis Jigal m’a répondu au début 2000. Et tout a commencé…
prédisposait pas à cet exercice. Avec la maturité, cette envie est devenue nécessité, mais j’ai compris qu’il s’agissait avant tout d’écrire des histoires. Je crois que les lecteurs demandent avant tout qu’on leur raconte des histoires. Le style que j’utilisais dans mes ouvrages de vulgarisation était bien adapté au type de romans que je voulais écrire. Mon attrait pour les quartiers de Marseille et pour les non-dits de l’Histoire a fait le reste. Mon ambition initiale n’était pas du tout d’être édité. C’est lorsque j’ai fait lire mon premier manuscrit à mon entourage que cette idée bizarre m’est venue. J’ai arrosé quelques maisons d’édition avec « La nuit des bras cassés », puis Jigal m’a répondu au début 2000. Et tout a commencé…
Si je parle de romans noirs de la mémoire, c’est parce que tous vos romans, du moins ceux que j’ai lus, s’inspirent d’événements historiques souvent oubliés, méconnus, ou même dissimulés. Je suppose que si vous avez choisi ces thèmes littéraires, c’est parce qu’ils vous ont marqué ?
Je suis d’une génération qui a grandi dans une France qui se glorifiait en réduisant son rôle dans la seconde guerre mondiale à la seule et héroïque Résistance. Puis il y a eu « Les sentiers de la gloire », « Le chagrin et la Pitié » et bien d’autres œuvres qui ont cassé le mythe et montré que l’Histoire officielle cachait des petites lâchetés et des grandes trahisons, que des millions d’hommes sur cette terre en avaient souffert. Puis, en approfondissant, je me suis rendu compte que le monde était loin d’être manichéen. Ça m’a donné envie d’en parler.
Par exemple dans Train bleu, train noir, vous placez deux « reportages » à cinquante ans de distance. L’arrestation supposée de truands locaux marseillais mais qui s’avérera une rafle déguisée des Juifs. Cinquante ans après, en 1993, quelques amis se rendent à Munich en compagnie de supporters de l’OM afin d’assister à la finale de la coupe de football entre les Marseillais et le Milan AC. Est-ce justement ce match qui vous a donné le point de départ, ou au contraire n’était-ce qu’une situation qui tombait à pic ?
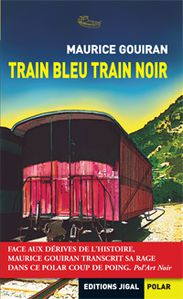 Non, c’est le prix polar SNCF (pour lequel j’étais le lauréat de l’été 2005) qui a tout déclenché. Lors de mes rencontres dans les CE, j’avais promis aux cheminots d’écrire un polar sur les trains. Alors les images tournées par la propagande allemande lors de l’embarquement sur le quai de la gare d’Arenc, en 1943 me sont revenues à l’esprit. 1943-1993, ça tombait à pic avec l’ambiance déjantée de la finale de la Coupe d’Europe. Le contraste fort m’a séduit, mais je craignais qu’on me reproche le rapprochement de deux événements très différents. Et puis parler de foot lorsqu’on veut mettre en lumière les dérives de l’Histoire n’est pas forcément bien vu par le microcosme cultureux marseillais !
Non, c’est le prix polar SNCF (pour lequel j’étais le lauréat de l’été 2005) qui a tout déclenché. Lors de mes rencontres dans les CE, j’avais promis aux cheminots d’écrire un polar sur les trains. Alors les images tournées par la propagande allemande lors de l’embarquement sur le quai de la gare d’Arenc, en 1943 me sont revenues à l’esprit. 1943-1993, ça tombait à pic avec l’ambiance déjantée de la finale de la Coupe d’Europe. Le contraste fort m’a séduit, mais je craignais qu’on me reproche le rapprochement de deux événements très différents. Et puis parler de foot lorsqu’on veut mettre en lumière les dérives de l’Histoire n’est pas forcément bien vu par le microcosme cultureux marseillais !
Dans Franco est mort jeudi, vous partez d’un fait-divers, presque banal, une lettre adressée à une vieille dame par une journaliste demeurant en Espagne, lui demandant d’établir une analyse ADN afin de démontrer ou non une filiation avec un Républicain disparu lors de la guerre civile. Là encore le lecteur voyage entre deux ou trois périodes ?
Il y a trois périodes. Aujourd’hui avec le fils. 1975 (la mort de Franco) avec la mère. 1939 (la Retirada) avec les réfugiés républicains. La guerre d’Espagne m’a toujours marqué et fasciné car c’était une guerre civile qui a déchiré les familles, les amis, un conflit qui a laissé des plaies profondes et qui a marqué le monde artistique avec « Guernica » de Picasso bien entendu, mais aussi avec des films comme « Viva la muerte » d’Arrabal. Très jeune, j’ai rencontré des républicains espagnols anarchistes et communistes qui avaient parfois des langages différents. Mais je ne pouvais guère écrire sur la guerre d’Espagne sans apporter des éléments nouveaux aux lecteurs. Deux découvertes m’ont incité « d’y aller » : celle des fosses communes (à partir de 2000), celle du camp de Karaganda en URSS. Et comme le hasard fait parfois bien les choses, le film « Les chemins de la mémoire » de José-Luis Peña est sorti simultanément. J’ai d’ailleurs participé à des soirées où j’ai présenté mon bouquin et animé des débats illustrés par ce film.
Dans Sur nos cadavres, ils dansent le tango, vous faites revivre des heures noires de la fin de la guerre d’Algérie et le régime des militaires en Argentine. Pourquoi avoir conjugué au présent plutôt qu’au passé composé le verbe Danser ?
Parce que cela donne plus de force au titre.
Dans Qui a peur de Baby Love, l’axe central est un institut catholique favorisant les idées extrémistes et les amitiés particulières au début des années 70. Là encore on retrouve l’ombre de l’OAS. Un thème que l’on pourrait qualifier de récurrent et que vous avez du mal à évacuer ?
Je ne suis pas obnubilé par l’OAS qui apparait dans 3 ou 4 de mes bouquins  (sur les 19 polars publiés), mais force est de constater que ses résurgences sont encore vives. Référez-vous aux polémiques autour de stèles honorant les membres de l’OAS (Marignane, Perpignan, Béziers, …). Le problème aujourd’hui est moins l’activité passée de l’OAS que la persistance de ses idées dans le monde actuel. Enfin, mon petit doigt me dit qu’on en entendra encore parler prochainement dans mes bouquins…
(sur les 19 polars publiés), mais force est de constater que ses résurgences sont encore vives. Référez-vous aux polémiques autour de stèles honorant les membres de l’OAS (Marignane, Perpignan, Béziers, …). Le problème aujourd’hui est moins l’activité passée de l’OAS que la persistance de ses idées dans le monde actuel. Enfin, mon petit doigt me dit qu’on en entendra encore parler prochainement dans mes bouquins…
Je continue avec Les vrais durs meurent aussi. Cette fois ce n’est plus l’Algérie qui sert de décor ou de support, mais le Vietnam, ou plutôt ce qui était l’Indochine. Et les réfugiés asiatiques, qui comme les Harkis ont été des laissés pour compte.
J’ai découvert le camp de Sainte-Livrade lors d’un salon du livre à Villeneuve-sur-Lot. La vision de ces vieilles indochinoises au regard vide et la découverte d’un camp de concentration dans la France du XXIème siècle m’a profondément ému et choqué. Le thème de « Les vrais durs meurent aussi » m’est alors apparu comme une évidence. Restait à inventer l’histoire qui allait avec…
Enfin, j’en arrive à Putains de pauvres, qui aurait pu n’être qu’une simple histoire de SDF victimes d’individus circulant en 4X4 et de l’épidémie de Chicungounia. Mais vous glissez insidieusement dans votre intrigue un poilu de la guerre 14/18.
On sortait de l’hiver 2007 et j’avais besoin de parler des pauvres, ou plutôt de l’image qu’en ont les politiques, les médias mais aussi – et surtout - l’homme de la rue. On sortait aussi de l’épouvantable épidémie de grippe aviaire, causé par le virus H5N1, qui avait décimé 2 poules et 3 canards. Le thème d’un roman basé sur une épidémie qui ne tuerait que les pauvres s’est imposé. J’avais les pauvres, restait à trouver l’épidémie. Je ne voulais pas du H5N1 dont on avait trop parlé, donc j’ai trouvé son cousin, le H1N1, le virus de la grippe espagnole, que tout le monde avait oublié mais qui avait causé la mort de 50 millions de personnes en 1918. D’ailleurs, le H1N1 a eu son heure de gloire par la suite sans que mon bouquin y soit pour quelque chose. Et comme vous connaissez ma perversité dès qu’on aborde l’Histoire, j’ai planqué un poilu de 14-18, apparemment mort de cette infection, dans une armoire !
 Il existe donc des constantes dans ces romans : des références aux guerres coloniales, aux dictateurs, et je suppose que vous ne traitez pas ces sujets sans arrière-pensée ?
Il existe donc des constantes dans ces romans : des références aux guerres coloniales, aux dictateurs, et je suppose que vous ne traitez pas ces sujets sans arrière-pensée ?
En fait, je traite ces faits parce qu’ils ont une étrange résonance dans le monde d’aujourd’hui. Prenez « Train bleu, train noir ». Au-delà du périple de ces deux trains, c’est bien le problème de la spéculation immobilière qui est visé. Si l’on considère que Marseille a perdu toutes ses industries (raffineries de sucre, tuileries, huileries, réparation navale, etc.…) et que la seule richesse de cette ville semble être actuellement l’immobilier, on voit que ce thème est très actuel. De même, les dissensions internes qui ont été fatales du camp républicain espagnol, dès 1936, ne vous rappellent-elles pas quelque chose ?
Cela demande une grosse documentation, afin que le lecteur pointilleux et historien quel que soit le côté politique où il se place, ne puisse pas dire qu’il ne s’agit que d’affabulations ?
Effectivement, l’écrivain n’a pas de légitimité historique. On écoutera plus facilement un agrégé d’Histoire négationniste qui possède, lui, cette légitimité. Mon travail m’incite donc à être pointilleux, vigilant, exigeant, à puiser des sources et à les vérifier constamment. En annexe de certains polars (« Marseille, la ville où est mort Kennedy », « Franco est mort jeudi », …), j’ai même ajouté des références bibliographiques). Il s’agit d’un travail long et délicat, mais d’autant plus nécessaire que j’aborde toujours des sujets polémiques qui contredisent parfois l’Histoire officielle. Il s’agit également d’un devoir de respect envers le lecteur. Je voudrais cependant préciser que le statut d’auteur nous donne un avantage sur les historiens, celui de mettre de la chair sur des événements. Les rencontres avec des témoins de faits que je raconte sont pour cela primordiales. Car elles vont générer des personnages, des gens comme vous et moi, plongés dans le drame. Dire que 1640 Marseillais ont été déportés un petit matin de janvier 1943, vers Compiègne, Drancy, puis Sobibor est un fait historique. Raconter le périple de six ou sept d’entre eux - des hommes, des femmes, des enfants, des vieux - dans le wagon à bestiaux donne au récit une toute autre dimension, très éloignée de la sécheresse des chiffres.
Pour quel ouvrage que vous avez écrit va votre préférence ?
Dans la mesure où je ne suis pas astreint à une quelconque productivité, je fournis les manuscrits à mon éditeur lorsque je les estime terminés, c'est-à-dire corrects. Je ne proposerai jamais un roman insatisfaisant à mes yeux ou qui ne serait pas marqué de ma sueur ou ma rage. Les 19 polars que j’ai écris sont, de ce point de vue, un peu mes enfants. Chacun a sa spécificité et son caractère. Je les aime tous, de manière parfois différente, mais je serai incapable d’en privilégier un par rapport aux autres. Celui qui m’importe le plus est celui que je suis en train d’écrire, celui que je conçois, l’enfant à venir. Ses grands frères vivent leur vie, bien ou mal, mais toute mon attention est concentrée sur le prochain. NB. Je remarque d’ailleurs que mes lecteurs ont des goûts différents lorsque je les interroge sur leur préférence.
Quel est celui qui vous a donné le plus de mal et pourquoi ?
Tous m’ont demandé beaucoup de travail, de documentation notamment mais aussi de lectures et de relectures incessantes. Si les auteurs étaient payés au SMIC pour les heures qu’ils passent sur un bouquin, ils gagneraient beaucoup plus que ce que leur rapportent leurs droits d’auteurs ! Je peux vous donner l’exemple de deux romans qui ont nécessité des attentions particulières et une refonte partielle. D’abord, « Train bleu, train noir » que j’avais commencé à écrire à la troisième personne du singulier et au passé et que j’ai repris sous la forme des trois récits au présent. Ensuite, « Qui a peur de baby Love ? », lorsque, le roman terminé, j’ai décidé de transformer le lieutenant de police – un gars dont j’ai oublié le nom - en fille sous les traits d’Emma Govgaline. Je peux vous assurer que, dans ce dernier exemple, il ne suffit pas de remplacer « il » par « elle » dans le traitement de texte !
Clovis est un personnage récurrent mais parfois en retrait comme dans « Sur nos cadavres, ils dansent le tango ». Une façon de laisser vos autres personnages prendre de l'ampleur, je pense à Emma Govgaline ?
Clovis apparait pour la première fois en 2003 dans mon 5ème roman,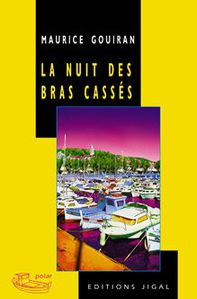 « Les martiens de Marseille », mais il n’est pas systématiquement le personnage central de tous mes romans depuis. Ainsi, il n’est qu’une ombre fugitive dans « Train bleu, Train noir » ou dans « Sous les pavés, la rage » qui se déroulent respectivement en 1993 et 1968. Je le trouvais alors un peu jeune et sans expérience pour y jouer un grand rôle. Je me méfie toujours un peu des personnages récurrents qui finissent par manger le cerveau de leurs auteurs-créateurs (cf Conan Doyle, Izzo ou Mankell). Je suis bien conscient des attentes du lecteur en ce domaine (j’ai reçu de sévères critiques pour « Sous les pavés la rage » parce que, pour la première fois depuis 2003, Clovis n’était pas le personnage central), mais je n’entends pas, pour autant, être pieds et poings liés avec mon personnage central. C’est pour cela qu’il laisse un peu la place à Emma dans le dernier opus, alors que son âge aurait pu l’autoriser à occuper le devant de la scène. Emma prend ainsi de l’épaisseur et reste, comme disent les politiques, « en réserve de la République » !
« Les martiens de Marseille », mais il n’est pas systématiquement le personnage central de tous mes romans depuis. Ainsi, il n’est qu’une ombre fugitive dans « Train bleu, Train noir » ou dans « Sous les pavés, la rage » qui se déroulent respectivement en 1993 et 1968. Je le trouvais alors un peu jeune et sans expérience pour y jouer un grand rôle. Je me méfie toujours un peu des personnages récurrents qui finissent par manger le cerveau de leurs auteurs-créateurs (cf Conan Doyle, Izzo ou Mankell). Je suis bien conscient des attentes du lecteur en ce domaine (j’ai reçu de sévères critiques pour « Sous les pavés la rage » parce que, pour la première fois depuis 2003, Clovis n’était pas le personnage central), mais je n’entends pas, pour autant, être pieds et poings liés avec mon personnage central. C’est pour cela qu’il laisse un peu la place à Emma dans le dernier opus, alors que son âge aurait pu l’autoriser à occuper le devant de la scène. Emma prend ainsi de l’épaisseur et reste, comme disent les politiques, « en réserve de la République » !
Dans ce roman il est à New-York et n'intervient que de manière subreptice. Une façon détournée pour lui proposer une enquête aux Etats-Unis ?
Pourquoi pas ? Honnêtement, je n’ai de bien concret en tête, mais j’y ai déjà pensé. New York est une ville qui me fascine et qui apparait déjà dans de nombreux romans. C’est, comme Marseille, une cité d’immigration qui gère les flux différemment de la cité phocéenne. A NYC, l’immigré évolue dans des quartiers bien délimités du Bronx, du Queens ou de Brooklyn où il retrouve une population de la même origine, avant de s’installer, en cas de réussite, à Manhattan. Les Italiens à Little Italy, les asiatiques dans Chinatown, etc … A Marseille, c’est plus diffus, c’est la ville qui évolue au rythme des flux d’immigration, c’est la ville, son langage, sa musique, ses habitudes, qui changent.
Enfin, cela fait trois questions en réalité, quel sera le thème de votre prochain roman ?
Je viens de terminer un roman qui risque d’être le prochain et dont je ne vous dévoilerai pas le thème car rien n’est encore figé et que je ne connais pas l’accueil que lui réservera mon éditeur. Est-ce une stupide superstition ? Why not… Devrais-je encore travailler sur ce roman ? Je n’en sais rien. J’ai hâte de le voir éclore, mais je sais aussi qu’un roman efface le précédent. J’aurais voulu communiquer davantage sur Franco que Videla projette dans l’ombre, et sur Videla que le prochain effacera des gondoles. Sachez seulement que Clovis redeviendra le personnage central de cette histoire et que cela se passera à Marseille au début des années 70. Ce choix marque, en quelque sorte, la distance que je prends avec la règle qui voulait que, jusqu’ici, Clovis n’apparaisse que dans des romans qui se déroulent de nos jours. Je peux seulement vous affirmer que le thème est fort et toujours très actuel.




/image%2F1226821%2F20150107%2Fob_17597e_paul-maugendre.jpg)
 Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter
Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter 