
En septembre 1913, paraissait la trente-deuxième et dernière aventure de Fantômas, le Maître de l’Effroi, sous la plume de Pierre Souvestre et Marcel Allain. Trente-deux volumes édités chez Fayard à raison d’un titre par mois.
L’aventure a commencé, en librairie, en février 1911, et qui pouvait imaginer un tel succès ! Un bandit devenir un héros, cela semble improbable et pourtant… Issu de l’imagination de deux hommes qui ont contractés un mariage littéraire, sous la houlette bienveillante de la compagne de Pierre Souvestre et qui à la mort de celui-ci deviendra celle de Marcel Allain, Fantômas fut favorablement accueilli par un lectorat avide de nouveautés libertaires. La critique, dont le plus virulent représentant est l’abbé Bethléem qui dans son guide Romans à lire et romans à proscrire, vitupérait contre les romans populaires en général, ne sera pas toujours tendre. S’il oublie de répertorier dans son ouvrage les romans de Souvestre et Allain, il réparera son omission dans son périodique La Revue des lectures. Mais il ne pouvait faire moins car il avait classé dans les romans à proscrire la série Zigomar, personnage sur lequel je reviendrai.
Fantômas est à considérer comme une mauvaise lecture pour les critiques littéraires de fictions policières qui s’appuient sur des concepts moraux et qui s’inquiètent des effets produits par ce genre littéraire auprès des masses populaires. Une prise de position qui ne peut que susciter l’engouement populaire. Fantômas s’est incrusté dans les esprits et après la guerre de 14-18, en 1927 exactement un contributeur de la Revue des lectures s’indigne en constatant que des lecteurs font relier leur collection de Fantômas et écrit : On fait relier de tels livres, alors que, très certainement, la collection des classiques est donnée en pâture aux rats et aux mites… concluant sa diatribe par : Je donne humblement à M. Edouard Herriot, ministre de l’intelligence française, le conseil de signer un petit décret qui enverrait sans tarder au bûcher tout le papier noirci dans le genre de celui que je signale. Une incitation, sinon au meurtre, du moins à la lecture de ces romans vilipendés.
Fantômas, un nouvel héros qui se démarque, même si Arsène Lupin était à classer dans la rubrique des mauvais garçons avec son passé de cambrioleur ? Pas tout à fait car il eut un prédécesseur : Zigomar de Léon Sazie créé en 1910. D’ailleurs il est amusant de remarquer une certaine ressemblance dans la présentation des personnages.
Vous savez qui c’est ?
Oui.
Qui ?
Zigomar !
Le détective américain sursauta.
Zigomar ! s’écria-t-il… Qui est ce Zigomar ?
Paul Broquet tranquillement répondit :
C’est Zigoma !
Tom Tweak s’était levé d’un bond.
Ça ne me dit pas qui c’est, ni ce que c’est que ce Zigomar…
C’est Zigomar… Je ne peux rien dire de plus.
A rapprocher de l’introduction de Fantômas :
? Fantômas !
? Vous dites ?
? Je dis... Fantômas.
? Cela signifie quoi ?
? Rien... et tout !
? Pourtant, qu'est-ce que c'est ?
? Personne... mais cependant quelqu'un !
? Enfin, que fait-il ce quelqu'un ?
? Il fait peur ! ! !
Et comme prédécesseurs on pourrait signaler Le mystérieux Docteur Cornélius de Gustave Le Rouge ou encore Fu Manchu de Sax Rohmer. Et si ces confrères en voyoucratie, à part Fu Manchu, sont tombés en désuétude, Fantômas continue à être régulièrement réédité, une notoriété largement entretenue par le cinéma qui dès 1913 c’est intéressé à son cas, Louis Feuillade réalisant cinq films. Et dans les années soixante André Hunebelle en réalisera trois avec Jean Marais et Louis de Funès dans les rôles principaux. L’excentricité de Louis de Funès gommant le tragique des situations.
Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux se penchent sur le berceau de Fantômas, narrant la genèse de ce Maître de l’effroi, qui de personnage populaire deviendra rapidement mythe littéraire sous l’influence indéniable de poètes comme Robert Desnos ou Max Jacob. On pourrait croire à une exagération patente des méfaits de Fantômas, pourtant Souvestre et Allain s’alimentaient en faits-divers pour écrire leurs histoires. Ecrire étant une façon de parler car ils travaillaient avec un ancêtre du dictaphone.
 Si Marcel Allain ressuscita Fantômas en 1926 pour trente quatre fascicules hebdomadaires puis récidiva quelques années plus tard soit par des feuilletons dans des journaux, des adaptations en bandes dessinées ou des feuilletons radiophoniques, c’est bien Fantômas, fils de Souvestre et Allain, qui imprègne les mémoires et alimente les rééditions.
Si Marcel Allain ressuscita Fantômas en 1926 pour trente quatre fascicules hebdomadaires puis récidiva quelques années plus tard soit par des feuilletons dans des journaux, des adaptations en bandes dessinées ou des feuilletons radiophoniques, c’est bien Fantômas, fils de Souvestre et Allain, qui imprègne les mémoires et alimente les rééditions.
Tout ceci et plus vous est expliqué, narré, commenté, analysé, décortiqué dans cet ouvrage dont il serait peu de dire qu’il se lit comme un roman policier, même si cette locution galvaudée est employée désormais un peu à tort et à travers. L’intérêt est sublimé par la nombreuse et riche iconographie et par des documents inédits issus du fonds Marcel Allain, lequel gardait précieusement tous ses documents, notifiant même mois après mois les droits concédés par Fayard pour les éditions initiales et les retirages des Fantômas première génération. Une source inestimable de renseignements.
Sérieuse, enrichissante, divertissante, cette étude permet de mieux comprendre l’engouement voué à Fantômas et même si on n’est pas un admirateur sans bornes de ce personnage, on lit avec plaisir ce document remarquable.
Matthieu Letrouneux est également le coauteur d'un ouvrage sur la maison d'éditions Tallandier : La Librairie Tallandier.
Loïc ARTIAGA & Matthieu LETOURNEUX : Fantômas ! Biographie d’un criminel imaginaire. Editions Les Prairies Ordinaires. 192 pages. 21,00€.




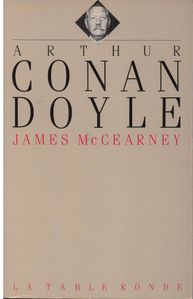
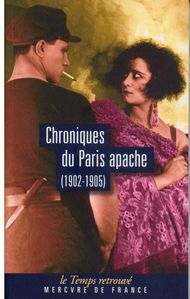





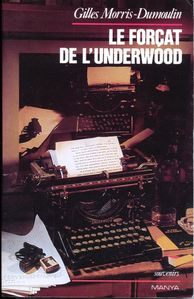
 Né au Havre le 16 janvier 1924, Gilles Morris-Dumoulin a vécu une enfance entre une mère possessive et un père qui entrainé de par ses fonctions sur le port du Havre sombra dans un alcoolisme l’emportant trop jeune à l’affection des siens, comme écrirait un auteur de mélos. Gilles occupe ses loisirs à lire, et ingurgite les méthodes Assimil, en véritable autodidacte, de l’Anglais, de l’Allemand, du Néerlandais, de l’Espagnol et de l’Italien. Ses débuts à la machine à écrire seront assez pragmatiques puisqu’il se fera les doigts chez un importateur de coton brut en tapant les factures.
Né au Havre le 16 janvier 1924, Gilles Morris-Dumoulin a vécu une enfance entre une mère possessive et un père qui entrainé de par ses fonctions sur le port du Havre sombra dans un alcoolisme l’emportant trop jeune à l’affection des siens, comme écrirait un auteur de mélos. Gilles occupe ses loisirs à lire, et ingurgite les méthodes Assimil, en véritable autodidacte, de l’Anglais, de l’Allemand, du Néerlandais, de l’Espagnol et de l’Italien. Ses débuts à la machine à écrire seront assez pragmatiques puisqu’il se fera les doigts chez un importateur de coton brut en tapant les factures.


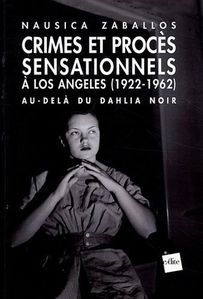
 Hollywood fascine les jeunes filles de Los Angeles et celles des états les plus reculés de l’Amérique. Les paillettes, la gloire les attirent et bon nombre d’elles vont s’y brûler les ailes. Clara Phillips fait partie de ces adolescentes qui rêvent de se faire un nom au cinéma, mais si elle devient célèbre, ce sera pour un triste fait divers. Elle sera même surnommée la tigresse. Mariée à quatorze ans avec Amour (prénom prédestiné) Lee Phillips, elle est inculpée de meurtre à vingt-trois ans. Son crime ? Avoir assassiné une rivale, Amour étant très volage. L’arme du crime : un marteau. Elle annonce la bonne (pour elle) nouvelle à son mari qui est catastrophé. Il fréquentait assidûment Alberta Meadows, une jeune veuve de vingt ans, il pense surtout à sa situation professionnelle et aux conséquences que la découverte de ce crime pourrait entraîner. Alors il aide Clara à effacer les traces du crime, mais celui-ci a eu un témoin, Peggy Caffee, une amie de sa femme. Si ce meurtre défraya la chronique, c’est surtout l’évasion de Clara Phillips de la prison de Saint Quentin qui enflamma les esprits. Ainsi que sa tentative de suicide. Cette histoire est narrée dans L’échappée belle de la Tigresse, première des affaires relatées.
Hollywood fascine les jeunes filles de Los Angeles et celles des états les plus reculés de l’Amérique. Les paillettes, la gloire les attirent et bon nombre d’elles vont s’y brûler les ailes. Clara Phillips fait partie de ces adolescentes qui rêvent de se faire un nom au cinéma, mais si elle devient célèbre, ce sera pour un triste fait divers. Elle sera même surnommée la tigresse. Mariée à quatorze ans avec Amour (prénom prédestiné) Lee Phillips, elle est inculpée de meurtre à vingt-trois ans. Son crime ? Avoir assassiné une rivale, Amour étant très volage. L’arme du crime : un marteau. Elle annonce la bonne (pour elle) nouvelle à son mari qui est catastrophé. Il fréquentait assidûment Alberta Meadows, une jeune veuve de vingt ans, il pense surtout à sa situation professionnelle et aux conséquences que la découverte de ce crime pourrait entraîner. Alors il aide Clara à effacer les traces du crime, mais celui-ci a eu un témoin, Peggy Caffee, une amie de sa femme. Si ce meurtre défraya la chronique, c’est surtout l’évasion de Clara Phillips de la prison de Saint Quentin qui enflamma les esprits. Ainsi que sa tentative de suicide. Cette histoire est narrée dans L’échappée belle de la Tigresse, première des affaires relatées.
 Thelma Todd, à l’inverse des « héroïnes » des précédentes affaires, ne se destinait pas au cinéma mais désirait devenir institutrice. C’est par sa mère qu’elle met un pied dans l’engrenage qui deviendra fatal. Elue Miss Massachusetts, elle est remarquée par des agents et se voit confier de petits rôles au cinéma. Après avoir suivi des cours d’art dramatique, payés par la Paramount, elle apparait dans Le bel âge, en 1926. Elle va tourner ensuite avec Gary Cooper, William Powell, les Marx Brothers et le duo Laurel et Hardy. Le passage du muet au parlant n’est pas fatal à sa carrière et elle devient rapidement une star adulée pour sa beauté. Elle est d’ailleurs rapidement surnommée Hot Toddy ou encore Ice-Cream-Blonde. Mais elle est retrouvée morte le 16 décembre 1935 dans sa voiture enfermée dans le garage de l'ex-actrice Jewel Carmen, également ex-épouse du compagnon et associé de Thelma, Roland West. La maison de Jewell Carmen est située non loin du restaurant de Thelma. La cause de la mort est déclarée due à un empoisonnement au monoxyde de carbone. Meurtre, suicide, accident, les témoignages divergent, sont contradictoires et peuvent être interprétés dans un sens ou un autre. Pourtant certains faits démontrent qu’elle n’aurait pu grimper les quelques deux cents marches qui menaient à son garage sans laisser de traces. L’affaire ne sera jamais véritablement résolue.
Thelma Todd, à l’inverse des « héroïnes » des précédentes affaires, ne se destinait pas au cinéma mais désirait devenir institutrice. C’est par sa mère qu’elle met un pied dans l’engrenage qui deviendra fatal. Elue Miss Massachusetts, elle est remarquée par des agents et se voit confier de petits rôles au cinéma. Après avoir suivi des cours d’art dramatique, payés par la Paramount, elle apparait dans Le bel âge, en 1926. Elle va tourner ensuite avec Gary Cooper, William Powell, les Marx Brothers et le duo Laurel et Hardy. Le passage du muet au parlant n’est pas fatal à sa carrière et elle devient rapidement une star adulée pour sa beauté. Elle est d’ailleurs rapidement surnommée Hot Toddy ou encore Ice-Cream-Blonde. Mais elle est retrouvée morte le 16 décembre 1935 dans sa voiture enfermée dans le garage de l'ex-actrice Jewel Carmen, également ex-épouse du compagnon et associé de Thelma, Roland West. La maison de Jewell Carmen est située non loin du restaurant de Thelma. La cause de la mort est déclarée due à un empoisonnement au monoxyde de carbone. Meurtre, suicide, accident, les témoignages divergent, sont contradictoires et peuvent être interprétés dans un sens ou un autre. Pourtant certains faits démontrent qu’elle n’aurait pu grimper les quelques deux cents marches qui menaient à son garage sans laisser de traces. L’affaire ne sera jamais véritablement résolue./image%2F1226821%2F20150107%2Fob_17597e_paul-maugendre.jpg)
 Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter
Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter 